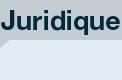|

Définition
La compensation est définie par le Code
civil : « lorsque deux personnes se trouvent débitrices, l’une envers
l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux
dettes…jusqu’à concurrence de leur quotité respective.
(article 1289 et suivants du Code civil)
Ce
mode particulier d’extinction de dettes réciproques et certaines, intervient
soit en dehors même de la volonté des parties lorsque les conditions légales ou
jurisprudentielles sont remplies, soit par l’effet d’un accord entre les
parties.
 |
La compensation légale
s’opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des
parties, du jour de la coexistence de deux dettes réciproques satisfaisant
aux conditions de l’article 1291 du Code Civil, soit la fongibilité, la
liquidité, et l’exigibilité de chacune des obligations.
En cas de contestation de l’une des parties, l’affaire sera portée devant la
juridiction compétente dont le rôle sera de constater la réunion ou non des
conditions légales de compensation. |
 |
La compensation
judiciaire est
prononcée par un juge, dès lors qu’un débiteur poursuivi en paiement d’une
dette opposera la créance qu’il détient sur le demandeur à l’instance, et
ce, en l’absence des conditions de liquidité et/ou d’exigibilité de la
compensation légale. Le juge s’attachera alors à s’assurer de la connexité
des obligations respectives. |
 |
La compensation
conventionnelle résulte
d’un accord par lequel les parties fixent en totale liberté les
conditions dans lesquelles leurs dettes réciproques pourront s’éteindre
simultanément. |
Le recours à la compensation conventionnelle
est une solution tentante en cas de faillite imminente de son cocontractant.
Mais attention, la conclusion d’un tel accord pendant la période suspecte risque
d’entraîner son annulation, et l’obligation pour le créancier du débiteur
défaillant de reverser les sommes perçues auprès des organes de la procédure.
Ce type d’accord ne peut donc être envisagé
qu’avec un co contractant « in bonis ».
Reconnaissance et mise en œuvre de la
compensation après l’ouverture d’une procédure collective
A l’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire, la loi pose deux principes :
Interdiction de paiement de toutes les dettes
nées avant le jugement d’ouverture.
Interdiction pour les créanciers antérieurs
de poursuivre en paiement le débiteur défaillant.
Les organes de la procédure vont s’attacher à
reconstituer l’actif de l’entreprise défaillante notamment en réclamant paiement
de tout ce qui lui est dû : un créancier débiteur peut alors se retrouver
contraint de s’acquitter de ses dettes, alors même qu’il serait dans
l’incapacité d’obtenir recouvrement de ses propres créances, non encore
exigibles à la date d’ouverture.
Mais depuis longtemps déjà, le mode
d’extinction simultané des obligations est admis par la jurisprudence et le
principe de compensation de créances connexes est apparue suffisamment légitime
aux yeux du législateur pour qu’il le valide expressément dans l’alinéa 2 de
l’article L621-24 du Code de commerce qui dispose que
« cette
interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances
connexes ».
Si la compensation légale n’a pas pu
fonctionner avant le jugement d’ouverture, notamment parce que l’une des dettes
n’était pas encore liquide ou exigible, l’interdiction de payer une dette née
avant le jugement d’ouverture ne fait pas obstacle au paiement
par
compensation de créances connexes.
La compensation constitue ainsi une garantie
pour le créancier chirographaire qui peut s’en prévaloir et éviter d’avoir à
payer au débiteur défaillant sa propre dette et n’avoir d’autre issue que
d’attendre vainement le paiement de sa créance antérieure au jugement
d’ouverture.
La condition sine qua non de la
reconnaissance de la connexité de deux créances par les juges du fond est la
déclaration de la créance par le créancier du débiteur failli.
Comme tout titulaire d’un droit de créance
antérieur au jugement d’ouverture, le créancier débiteur de l’insolvable doit
déclarer sa créance dans les délais prescrits (article 50 et suivants de la loi
1985, devenu l’article L. 621-43 et suivants).
Si la Loi a validé le principe de
compensation entre dettes et créances connexes, elle a laissé le soin à la Cour
de Cassation de définir les contours de cette notion.
La connexité est constatée lorsque des
créances réciproques résultent d’un même contrat ou ont pris naissance à
l’occasion de la même convention.
La jurisprudence a étendu de manière décisive
la notion de connexité en la libérant des relations contractuelles strictement
synallagmatiques. Elle a admis la compensation renforcée des dettes connexes
alors, pourtant, que celles-ci n’étaient pas nées d’un même contrat.
C’est ainsi qu’il peut y avoir compensation
dès lors que les créances et les dettes nées de plusieurs conventions,
constituent les éléments d’un ensemble contractuel unique, servant de cadre
général aux relations d’affaires entre les parties.
(cassation commerciale, 14 mars 2000,
n°97-16.752)
L’absence de définition claire et précise
explique le large contentieux et l’insécurité juridique dans laquelle se
trouvent encore les créanciers débiteurs.
Il apparaît toutefois que la Cour privilégie
la référence au cadre contractuel, et semble rechercher pour reconnaître la
connexité, l’existence d’un lien entre les différentes opérations commerciales
et juridiques.
Compte tenu de la jurisprudence actuelle, il
paraît prudent, dans le cadre de relations d’affaires croisées, de prévoir
conventionnellement la compensation, et fixer son mode de déclenchement,
notamment en cas de procédure collective.
Ces conventions devraient bien évidemment
intervenir, au mieux à la naissance des relations commerciales, et en tout état
de cause avant que le cocontractant ait connaissance de la situation de
cessation des paiements de son partenaire.
|